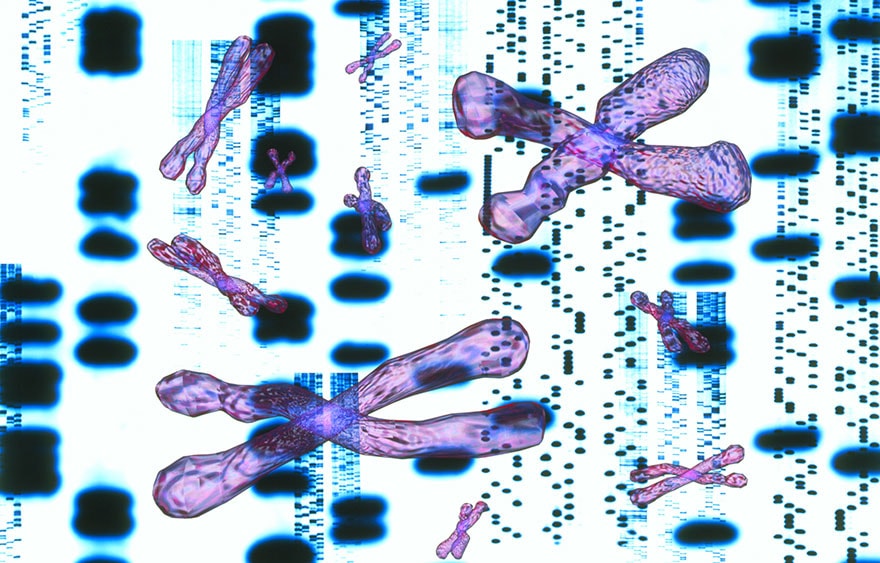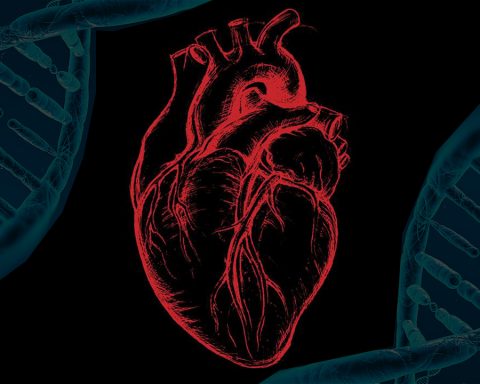Biosourcé versus biodégradable
Des prises de risque variables

Vertus environnementales


Comment afficher le stockage du carbone ?
Revitaliser les territoires




Des stratégies en devenir
Lever les freins
Valoriser les biodéchets

Freins techniques et formation des acteurs
Revaloriser le capital nature et la production végétale

- Directive (UE) 2018/851 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Texte du 30/05/2018, paru au Journal Officiel de l’UE le 14/06/2018
- Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer/Ministère du logement et de l’habitat durable, & Karibati, Structuration et développement des filières de matériaux de construction biosourcés, Plan d’actions n° 2, avancées et perspectives, octobre 2016. www.cohesion-territoires.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fstructuration_et_developpement_des_filieres_de_materiaux_de_con struction_biosources_-‐_octobre_2016.pd
- A. Lammel, Changement climatique : de la perception à l’action, Les Notes de la FEP, n°5, septembre 2015.